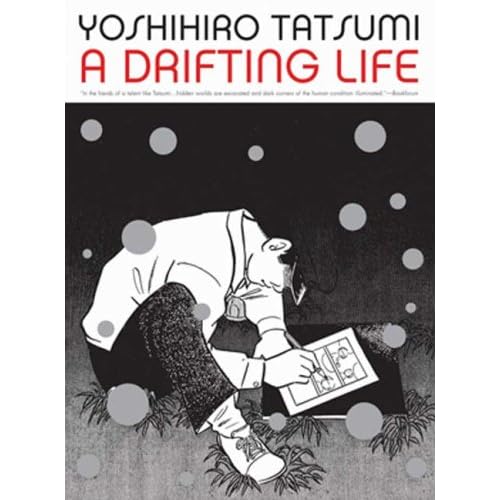En février dernier, Karine ressortait ici même le White album de Joan Didion en v.o. (balançant là un de ses plus beaux post), au prix d'un effort linguistique délirant. Toujours aussi polyglotte, Gatitox, depuis Londres, tirait à boulets rouges (forcément rouges) : «Pauvre France... Vos librairies sont pleines et vous n’avez toujours pas de traduction disponible des articles mythiques de Joan Didion !!!!!! ». Il avait raison: honte à Paris, donneuse de leçon et portant incapable de traduire en temps et en heure les cinq-six trucs essentiels sans lesquels ce blog n'existerait pas. Néanmoins, une anthologie de chroniques traduite en français a paru depuis, au début du printemps, sous le titre l’Amérique (chez Grasset). Satisfaction dans les rangs de Discipline, joie dans les maisons francophones, danse de St Guy chez les libraires.
De là, cette idée folle: et si nous revenions dessus... et si nous enfoncions le clou. Mais sans note critique, cette fois... seulement le désir simple et immédiat de vous offrir une page complète (la 96). Pas un geste commerçant, juste une page de pure littérature en guise de piqûre de rappel, histoire de vous faire partager ces lignes, qui sont parmi les plus belles jamais écrites sur le monde de la pop culture et sa flamboyante désinvolture. Enjoy.
« Un jour, quelqu’un amena Janis Joplin à une fête à la maison de Franklin Avenue ; elle venait de donner un concert et elle voulait un Brandy–Bénédictine dans un grand gobelet à eau. Les musiciens ne voulaient jamais des boissons ordinaires. Ils voulaient du saké, ou des cocktails à base de champagne, ou de la tequila sec. Passer du temps avec des musiciens était déroutant et exigeait une approche d’une souplesse et, au fond, d’une passivité que je n’ai jamais pu tout à fait acquérir. D’abord, le temps n’avait aucune importance : nous dînerions à neuf heures, ou alors à onze heures et demie, à moins que nous ne commandions à manger plus tard. Nous irions à l’USC voir le Living Theater si la limousine arrivait au moment précis où personne n’aurait préparé à boire ou sorti une cigarette ou organisé un rendez-vous avec Ultra Violet au Montecito. De toute façon David Hockney arrivait. De toute façon Ultra Violet n’était pas au Montecito. De toute façon nous irions à l’USC voir le Living Theater ce soir ou nous irons voir le Living Theater un autre soir, à New York, ou à Prague. D’abord nous voulions de sushis pour vingt personnes, des palourdes à la vapeur, un curry de légumes vindaloo et beaucoup de cocktails à base de rhum avec des gardénias pour mettre dans nos cheveux. D’abord nous voulions une table pour douze, quatorze maximum, mais il y aurait peut-être six personnes de plus, ou huit, ou onze : il n’y en aurait jamais un ou deux de plus, parce que les musiciens ne se déplaçaient jamais par groupe de « un » ou « deux ». John et Michelle Phillips, des Mamas and Papas, se rendant à l’hôpital pour la naissance de leur fille Chynna, obligèrent la limousine à faire un détour par Hollywood pour passer prendre une amie, Anne Marshall. Cet incident, que je réimagine souvent en incluant un second détour, par le Luau pour prendre des gardénias, décrit très exactement l’industrie de la musique à mes yeux. »
Joan Didion, L’Amérique, traduit par Pierre Demarty, Grasset 2009